 par François Gèze, Mediapart, 26 août 2017
par François Gèze, Mediapart, 26 août 2017
https://blogs.mediapart.fr/francois-geze/blog/260817/moussa-tchangari-une-etude-majeure-pour-comprendre-la-guerre-sans-fin-au-sahel
Le 17 août, l’éditorial du Monde « Au Sahel, la crainte d’une guerre sans fin » concluait, sans expliquer : « La réponse militaire s’est jusque-là montrée très insuffisante pour venir à bout de groupes qui recrutent en jouant sur des frustrations économiques ou communautaires auxquelles aucune solution n’est apportée. » L’analyste nigérien Moussa Tchangari apporte les explications qui manquent.
Le 17 août 2017, l’éditorial du Monde « Au Sahel, la crainte d’une guerre sans fin » se concluait, mais sans donner plus de précisions, sur ce constat fort pertinent : « La réponse militaire s’est jusque-là montrée très insuffisante pour venir à bout de groupes qui recrutent en jouant sur des frustrations économiques ou communautaires auxquelles aucune solution n’est apportée. » D’où l’importance, pour en savoir plus sur les racines de cette « guerre sans fin » du Sahel, de se tourner vers les observateurs locaux, dont les travaux, trop méconnus des grands médias occidentaux, apportent souvent des clés essentielles pour comprendre les ressorts profonds de conflits obscurs où sont pourtant directement impliquées les « grandes puissances ». Au premier rang desquelles la France, dont les responsables actuels semblent bien y agir toujours sans parvenir à se libérer du vieux « logiciel colonial » qui a formaté les cerveaux de générations d’« élites républicaines » tout au long du xixe siècle et jusqu’aux années 1960.
C’est ce dont atteste la remarquable étude de Moussa Tchangari, secrétaire général de l’ONG nigérienne Alternative Espaces Citoyens, intitulée Sahel : aux origines de la crise sécuritaire. Conflits armés, crise de la démocratie et convoitises extérieures, publiée deux jours après l’éditorial du Monde, le 19 août 2017, et accessible ici ou là. Celle-ci est principalement consacrée aux failles gravissimes de la réponse de la « communauté internationale » à la conjonction des entreprises « djihadistes » de la secte Boko Haram, qui sévit au nord du Nigeria depuis 2002, et des divers groupes armés « islamistes » actifs dans les différents États du Sahel (Mali et Niger principalement) et du Sahara (Algérie – voir mon article de 2014 sur le rôle spécifique de ce pays –, Mauritanie, Libye, Tunisie), surtout depuis les années 2010. Une étude de 52 pages, qui mérite une lecture attentive, tant elle est riche en informations de première main, que l’on retrouve rarement dans les médias dominants, anglophones comme francophones. Son auteur, Moussa Tchangari, est en effet un acteur de premier plan de la « société civile » de son pays, le Niger (et membre de longue date du conseil d’administration de la Fondation Frantz Fanon, qui réunit des militant-e-s internationalistes de tous les continents).
Avant d’évoquer quelques-uns des apports à mon sens essentiels du travail de Tchangari, je dois souligner qu’il complète très utilement une autre étude tout aussi passionnante, remarquablement documentée, du politologue Jean-François Bayart sur les racines du salafisme et du djihadisme nord-nigérians et de l’« économie politique » de Boko Haram, qu’il a publiée au même moment, le 18 août2017, sur son blog de Mediapart : « De quoi Boko Haram est-il le nom ? ». Il y montre fort pertinemment que l’extension de la secte et de ses actions mortifères est loin de s’expliquer uniquement par son prosélytisme religieux islamiste : « Boko Haram est l’expression contemporaine d’un système économique régional séculaire qui s’est structuré entre Fort-Lamy (Ndjamena), Kousseri et Maiduguri, sur les ruines de l’économie saharienne et esclavagiste de la fin du xixe siècle, grâce aux “gains marginaux” qu’ont engendrés les frontières étatiques, le marché cambiaire à l’interface du naira et du franc CFA, le développement des routes et du chemin de fer, les disjonctions entre les cycles économiques du Nigeria et ceux de ses voisins, les cours changeants du pétrole qui affectent les deux producteurs du bassin, le Nigeria et le Tchad, et, enfin, les conflits armés, de l’aventure de la 2e DB pendant la Seconde Guerre mondiale, à partir de Fort-Lamy, aux rébellions postcoloniales tchadiennes, en passant par la guerre du Biafra. La secte met en termes religieux une insurrection sociale et politique contre l’iniquité de ce système et de la classe dominante qui en tire profit, et ouvre des opportunités à ceux qui en sont les subalternes et les victimes. »
Dans l’étude de Tchangari, le chapitre intitulé « L’irruption terroriste de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad » confirme implicitement cette analyse, tout en soulignant les raisons de l’incapacité des puissances occidentales et des États de la région à faire face efficacement à cette « irruption ». Pour les premières, selon lui, l’objectif premier était en réalité d’y contrer les ambitions économiques chinoises : « L’expansion rapide de Boko Haram est venue donner un coup d’arrêt au projet pétrolier nigérian dans le bassin du lac Tchad, en même temps qu’elle a retardé celui du Niger consistant à se connecter au pipe-line Tchad-Cameroun pour l’exportation de son pétrole brut. La particularité de tous ces projets tient d’abord au fait qu’ils sont exécutés avec des compagnies chinoises ; ensuite, au fait qu’ils visent chacun à accroître la marge d’autonomie des pays porteurs. Le résultat de l’expansion de Boko Haram est que les États riverains du bassin du lac Tchad, qui avaient fondé tous leurs espoirs sur leurs projets pétroliers, étaient tous confrontés à des difficultés économiques énormes ; au point qu’ils avaient beaucoup de mal à assurer les fins de mois de leurs fonctionnaires et à relever les défis sécuritaires et humanitaires posés par Boko Haram. »
Mais pour Tchangari, si les États de la région du bassin du lac Tchad n’ont pas été capables de faire face à l’ampleur de la menace de Boko Haram, « c’est d’abord parce [qu’ils] n’ont pas su asseoir, après plus d’un demi-siècle d’indépendance, un modèle de gouvernance démocratique et de développement social et économique inclusif. La particularité des contrées où ce groupe terroriste a pu prospérer, qu’il s’agisse du Nord-Est du Nigeria, du Nord-Cameroun, du Sud-Est du Niger ou de l’Ouest du Tchad, ne tient pas seulement en effet au fait qu’elles recèlent d’importantes réserves de pétrole, objet de toutes les convoitises extérieures : elle est également qu’il s’agit essentiellement de régions périphériques, durablement affectées par les conséquences du changement climatique, bénéficiant très peu des investissements publics, et surtout livrées à l’incurie d’une administration étatique parfois très corrompue et encline à user de la force chaque fois qu’elle s’est sentie remise en cause. Boko Haram a ainsi davantage bénéficié de la mauvaise gouvernance des États de la région, marquée par la corruption et l’absence d’une culture de respect des droits et de dialogue, que des manœuvres bien réelles des grandes puissances pour le contrôle des ressources du sol et du sous-sol. »
Telle est la thèse majeure de Tchangari, remarquablement documentée par les trois autres chapitres de son étude, dont le constat introductif fait froid dans le dos : « La tentation de la violence armée continue visiblement d’être très forte au sein d’une jeunesse sahélienne, urbaine et rurale, animée par un sentiment d’abandon et d’injustice, et surtout largement convaincue qu’aucun changement significatif ne peut se réaliser de manière pacifique. Venant d’une jeunesse qui n’a pas ou peu connu les régimes autoritaires civils et militaires successifs, ce sentiment est lourd de sens : il sonne comme un échec cinglant de tout ce qui a été entrepris pendant un quart de siècle pour pacifier l’espace public. La démocratisation n’a pas tenu ses promesses. Et pas seulement celle de pacifier l’espace public. »
D’où la critique sévère que dresse l’auteur des « graves limites » du « Plan d’action pour la prévention de l’extrémisme violent » adopté par l’ONU en décembre 2015. S’il admet que l’adoption de ce plan « révèle une prise de conscience mondiale quant à l’existence d’un lien évident entre extrémisme violent et terrorisme, et la nécessité d’apporter à ce dernier une réponse plus globale, qui ne se limiterait pas aux mesures sécuritaires », il souligne l’illogisme d’en confier la mise en œuvre au Sahel à des États quasi faillis et profondément corrompus qui, depuis que duraient les conflits régionaux n’ont accompli « aucun effort significatif […] pour (re)construire des liens de confiance plus étroits entre les citoyens et leurs institutions ». D’autant plus, pointe-t-il également, que « l’absence d’une définition claire de la notion d’“extrémisme violent” dans le cadre du plan d’action [est] une source potentielle d’amalgame entre cette notion et celle de terrorisme ». « Près de deux ans après l’adoption du plan d’action, précise-t-il, il est aisé de mesurer l’ampleur des problèmes que soulève l’absence d’une définition claire de la notion d’extrémisme. Car cette situation permet à chaque État de bâtir son plan d’action en fonction de sa propre compréhension du phénomène, voire des intérêts de l’élite au pouvoir. […] L’exemple le plus évident est celui de l’espace sahélien où, bien qu’aucun gouvernement ne remette ouvertement en cause la pertinence de ce plan, la plupart d’entre eux ont fait le choix de n’agir que contre “le facteur humain et les motivations personnelles” conduisant à la radicalisation qu’il évoque, au lieu de s’attaquer aux “facteurs structurels et conjoncturels propices à l’extrémisme violent” qu’il mentionne également.
Très saisissante est également l’analyse que propose Tchangari des racines du « déficit structurel de démocratie » des États de la région, en particulier du Mali et du Niger : « Les avancées démocratiques enregistrées au cours des dernières décennies n’ont réduit que faiblement la place prépondérante occupée par le recours à la violence dans la gestion des affaires publiques ; car, malgré les limites qu’impose l’état de droit, ainsi que les résistances de plus en plus fortes de la société elle-même, la plupart des pouvoirs africains, y compris ceux qui tirent leur légitimité des urnes, fonctionnent essentiellement sur une logique de rapports de forces. La corruption a atteint un seuil tel que les agents publics sont devenus dans beaucoup de secteurs des opérateurs privés agissant sous le parapluie de la puissance publique ; ils se tiennent entre eux et s’entendent pour reproduire un système fondé sur une logique de prédation et d’extorsion permettant à chacun de tirer, en toute impunité, une rente à partir de la position qu’il occupe. […] L’erreur que commettent beaucoup d’analystes vient du fait qu’ils perdent souvent de vue que la corruption qui gangrène l’appareil d’État, tout comme d’ailleurs le climat d’impunité qu’on observe partout, est un des piliers du système politique et économique en Afrique. Ce système ne peut pas être analysé comme un “système capitaliste normal” comparable à ce qui a cours sous d’autres cieux, même s’il en présente certaines caractéristiques essentielles ; il s’agit plutôt d’un système hybride fondé sur la prédation, animé par ce que Frantz Fanon appelle une bourgeoisie nationale, “tout entière canalisée vers des activités intermédiaires”, avec une “psychologie d’hommes d’affaires non de capitaines d’industrie”. »
D’où un constat assez redoutable : « On comprend donc pourquoi l’extrémisme violent a trouvé facilement des adeptes déterminés dans les pays où la violence de l’État, active et passive, n’a rencontré jusqu’ici que quelques résistances molles ; mais, on comprend aussi le dilemme face auquel se retrouvent aujourd’hui des élites au pouvoir qui réalisent que la violence du système n’arrive plus à dissuader la révolte, et qu’il n’y a dans la société elle-même que peu de mécanismes fonctionnels pour en prendre le relais. […] La guerre contre les groupes armés terroristes n’est plus, au Sahel, l’affaire des seuls gouvernements nationaux. Mais elle n’est pas non plus l’affaire des seuls groupes armés djihadistes ou indépendantistes. […] Aucun [de ces] belligérants ne dispose d’une marge de manœuvre suffisante pour déterminer les conditions de règlement du conflit, [car ils] sont doublement prisonniers : d’abord des justifications politiques et idéologiques qu’ils ont eux-mêmes données à cette guerre (défense de l’intégrité territoriale, de la démocratie et de la laïcité pour les uns, instauration d’un État islamique, indépendance ou autonomie pour les autres) ; ensuite de leurs soutiens extérieurs, qui n’ont pratiquement rien à perdre dans cette guerre et bien plus à gagner dans sa poursuite.
« Cette guerre qui a fait tant de morts, de blessés, de réfugiés, de déplacés internes, n’est en effet pas une catastrophe pour tout le monde. Ce déferlement de violence, dont beaucoup peinent à saisir la finalité, n’est certainement pas le signe d’une folie ; il s’inscrit dans un vaste projet dont seuls semblent connaître le but ultime ceux qui ont les moyens de l’arrêter et qui ne le font pas. Cette guerre est une aubaine, d’abord pour les grandes puissances occidentales, en premier lieu la France, qui semblent en tirer avantage pour renforcer leur influence. » Mais aussi pour la Chine, dont Tchangari démonte efficacement le jeu géopolitique et économique dans la région.
Enfin, l’étude met justement l’accent sur le rôle des attentes déçues des jeunes dans le fait qu’ils sont prêts à succomber à la tentation de la révolte violente. Or, Tchangari l’affirme avec force (et le démontre efficacement) : « La préoccupation centrale des États, tout comme d’ailleurs de certaines ONG, se résume à la question de savoir comment prévenir l’extrémisme violent au sein de la jeunesse. Autrement dit, comment empêcher que les jeunes des villes et des campagnes rejoignent les différents groupes armés, principalement les groupes djihadistes et irrédentistes. […] En dépit de toutes les mises en garde [ONU, Banque mondiale, AFD], aucun des États sahéliens ne dispose à l’heure actuelle d’une politique conséquente d’insertion professionnelle des jeunes. Moins du fait de l’absence d’une prise de conscience aiguë quant à l’enjeu que représente le chômage massif des jeunes urbains et ruraux pour leur propre stabilité, qu’en raison d’un environnement économique de plus en plus défavorable. » Et il ajoute que, « au Mali et au Niger, la crise des systèmes éducatifs est devenue le révélateur le plus éloquent de la crise globale à laquelle ces pays sont confrontés ».
La conclusion de Tchangari est sombre, même si elle donne bien les clés pour éviter le piège de la « guerre sans fin » au Sahel : « Les initiatives en cours dans les pays sahéliens, notamment au Mali et au Niger, ont très peu de chances de les sortir de l’engrenage de la violence armée. Pas seulement parce qu’elles ne sont pas suffisamment ambitieuses en matière d’insertion sociale des jeunes, mais surtout parce qu’elles se mettent en place dans un contexte où l’autoritarisme d’antan semble revenir de mode. La dégradation de la situation sécuritaire favorise insidieusement une certaine tentation autoritaire qui se manifeste aussi bien dans la praxis des pouvoirs en place que dans certains discours ambiants tentant d’établir un lien de cause à effet entre l’avènement de la démocratie multipartite et la situation présente des pays sahéliens. […]
« Servant donc aujourd’hui de justification à la présence militaire extérieure et à un certain raidissement des pouvoirs en place, l’existence des groupes armés pourrait aussi servir demain de moyen pour étouffer toute velléité de changement politique susceptible de remettre en cause les intérêts des puissances étrangères. Et c’est certainement la raison pour laquelle ces dernières se sont installées dans une logique que le citoyen ordinaire peine à croire, à savoir celle de ne pas donner aux pays les moyens de se défendre et de ne pas non plus encourager le dialogue avec certains des groupes armés. L’option d’un dialogue politique avec les groupes armés se réclamant de la mouvance djihadiste [reste] un tabou bien ancré tant au Niger qu’au Mali : personne n’y ose apparemment envisager la perspective d’une ouverture du champ politique aux partisans de l’islamisme politique. […]
« Le Sahel ne pourra sortir de la situation actuelle qu’au prix d’une révolution, dont on peut toutefois se demander si elle est encore possible. La réponse est difficile, on peut juste dire que la nécessité fera certainement loi. Le “désir d’insurrection”, comme le dit Achille Mbembe, est bien réel partout sur le continent. Il appartient à ceux qui en ont assez de la situation présente, les jeunes en premier lieu, de savoir le canaliser vers le changement souhaité. Ce changement, peu de forces sont encore à l’œuvre pour le réaliser, et beaucoup d’obstacles restent à surmonter pour qu’il se fasse en dehors de la voie toute tracée aujourd’hui de la violence armée. Ceux qui veulent le réaliser doivent donc avoir à l’esprit qu’ils auront face à eux une coalition d’intérêts nationaux et internationaux habituée à user de la violence pour briser toute initiative du genre. Ils doivent aussi être conscients que la tentation de la violence est aujourd’hui, pour tout mouvement de changement politique et social, la voie royale de sa propre liquidation et de la perpétuation du système dominant. »
Accueil Infos Maghreb et Machrek Moussa Tchangari : une étude majeure pour comprendre la « guerre sans fin » au...





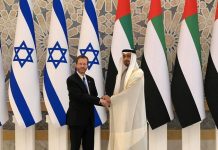









[…] continue reading […]