par François Gèze*
Revue MOUVEMENTS 2020 n° 102
https://editionsladecouverte.fr/

Les médias français dominants ont été largement pris de cours par l’irruption du Hirak, au point d’en proposer souvent des analyses largement décalées par rapport à la réalité. Pour tenter de comprendre ce décalage, cet article revient sur les circonstances des années 1990, quand la « sale guerre » qui a brisé la société algérienne s’est accompagnée en France de campagnes de désinformation systématiques. Et il explique comment l’ampleur inédite du mouvement a contribué en France à l’émergence progressive d’un regard nouveau, moins chargé d’idéologie, sur l’Algérie contemporaine.
En Algérie comme à l’étranger, les médias dominants ont été pris de cours par l’irruption soudaine du mouvement, son ampleur et ses caractéristiques inédites. Mais en France, leur surprise a été d’autant plus grande que, depuis près de vingt ans, l’actualité algérienne restait largement absente de leurs colonnes, et très discrète dans les travaux académiques, eux-mêmes peu médiatisés. Une situation contrastant avec le « trop plein » des années 1990, quand la situation d’hyperviolence ayant suivi le coup d’État de 1992 avait donné lieu à un flot d’informations contradictoires et, souvent, de désinformation. Comment comprendre ce hiatus, qui n’a pu être sans conséquences dans la couverture des événements de 2019 ? On ne peut tenter de répondre à cette question sans un peu d’histoire, afin d’éclairer la difficulté pour nombre de médias français (en particulier audiovisuels) d’analyser à chaud les ressorts profonds du Hirak.
La difficulté de bien cerner le rôle historique de la police politique
Beaucoup se sont ainsi logiquement interrogés sur l’absence en son sein de leaders à même de proposer une alternative au régime ou, à tout le moins, de se constituer en porte-parole crédible du mouvement pour négocier avec les représentants du pouvoir réel – les chefs de l’armée – les conditions d’une transition progressive vers la démocratie revendiquée par des millions d’Algérien·ne.s. Souvent, il a été pertinemment relevé que cette absence de leaders était le fruit de la lucidité populaire : par dizaines de milliers, slogans, chants et pancartes des manifestant·es des vendredis (et des mardis estudiantins) ont en effet dénoncé sans détour les méthodes du « système », visant, à travers sa police politique omniprésente depuis l’indépendance, à infiltrer, manipuler et « cloner » tout embryon de mouvement d’opposition. Mais ces observateur·rices perspicaces ont souvent omis, ce que l’on peut comprendre tant cette question reste peu médiatisée (bien qu’assez documentée), de resituer la chronologie de ces manipulations, se privant du coup de mieux comprendre certaines apories apparentes du hirak de 2019. Beaucoup sont en effet resté.e.s englué.e.s dans le storytelling produit depuis vingt ans par les officines du régime, selon lequel le président Abdelaziz Bouteflika était au cœur du pouvoir, alors même que depuis son grave AVC de 2013, il était réduit à un état purement végétatif, incapable de prendre la moindre décision. Un storytelling visant précisément à occulter le rôle majeur des vrais « décideurs », les chefs de l’armée et de la police politique.
L’histoire détaillée de cette dernière reste assurément à faire[1]. On sait que le MALG (ministère de l’Armement, des Liaisons générales et de la Communication), service de renseignement de l’ALN créé en 1960, est devenu au lendemain de l’indépendance, dès septembre 1962, la Sécurité militaire (SM), rebaptisée Département du renseignement et de la sécurité (DRS) en 1990, puis Direction des services de sécurité (DSS) en 2016 (et encore renommée depuis). Mais on sait moins l’évolution historique de son rôle, marquée par trois périodes assez distinctes, même si les fondements essentiels sont restés inchangés. La première période a été celle des années 1962-1978, quand la « SM » de Ben Bella puis de Boumediene utilisait, pour éliminer les opposants potentiels, les méthodes apprises par ses agents auprès des services français et, surtout, du KGB russe, de la Stasi est-allemande et de la Securitate roumaine. La manipulation et la désinformation, mais aussi la répression brutale, la torture systématique et les assassinats ciblés étaient alors ses méthodes privilégiées. Sous la présidence de Chadli Bendjedid (1979-1992), coopté par les chefs de l’armée et de la SM, ces derniers ont conservé l’usage de ces méthodes, tout en attribuant une place croissante à l’« action psychologique », notion désignant les opérations de désinformation et de manipulation de l’opinion. Avec le coup d’État du 11 janvier 1992, interrompant les élections législatives qui allaient donner la majorité parlementaire au Front islamique du salut (FIS) – avec seulement 24,5 % des inscrits au premier tour –, s’est ouverte une troisième période du fonctionnement de la police politique : ses divers services opérationnels et d’action psychologique ont été au cœur de la terrible guerre contre les civils qui a marqué les années 1990[2]. Ils en conserveront ensuite les réflexes et les techniques pour détruire avec méthode, à partir des années 2000, toutes les initiatives visant à restaurer les principes de la démocratie.
Infiltrées, corrompues ou « clonées », les directions des organisations d’opposition (partis politiques, syndicats autonomes, associations, etc.) ont été méthodiquement mises sous contrôle par la police politique. Et c’est bien parce que les millions de « hirakistes » en étaient conscient·e.s qu’ils et elles se sont organisé·e.s sans leadership affiché[3].
De surcroît, les éditorialistes prompts à pointer les faiblesses du mouvement, voire son échec, semblent avoir oublié que la conjoncture politique de 2019 n’a plus rien à voir avec celle de 1989-1991, quand la présence de technocrates et de responsables politiques intègres avait permis, à la faveur d’une (trop brève) période d’« ouverture démocratique sous contrôle », d’engager d’authentiques réformes économiques et politiques ; ni même avec celle de 1995, au plus fort de la guerre intérieure, quand des dirigeants politiques hautement respectés par la population, comme Hocine Aït-Ahmed (Front des forces socialistes) et Abdelhamid Mehri (FLN), avaient permis l’adoption avec les dirigeants du FIS de la « Plateforme de Sant’Egidio », proposant au régime – sans succès – un programme de retour à la paix civile. En 2019, rien de tel : ces opposants historiques n’étaient plus de ce monde et leurs héritières et héritiers, réprimé·es et affaibli·es, parfois retourné·es, n’étaient aucunement pas en condition de construire une alternative politique crédible[4] ; tandis que des dizaines de milliers de cadres de valeur avaient dû choisir l’exil, conduisant à un affaiblissement dramatique du fonctionnement des entreprises publiques et des structures administratives. D’où la légitime prudence des manifestant·e.s des vendredis et des mardis, dont les plus politiques (plus nombreux·ses qu’on le croit souvent), convaincu·e.s que la transition vers la démocratie prendrait des années, ont choisi de travailler collectivement dans la discrétion.
S’il n’est donc pas possible, au printemps 2020, de spéculer sur ces perspectives, faute d’informations sur les réseaux souterrains du Hirak, il n’est en revanche pas inutile de revenir sur les raisons profondes de la « grande surprise » ayant saisi les médias français dominants face à son irruption. Lesquelles renvoient largement aux biais idéologiques résultant de l’incapacité durable des responsables politiques français·e.s à reconnaître les terribles réalités de la longue violence coloniale en Algérie. Une clé essentielle pour comprendre l’aveuglement médiatique face aux réalités de l’Algérie indépendante, tout particulièrement lors de la « sale guerre » qui a brisé sa société de 1992 jusqu’au début des années 2000.
L’héritage médiatique de la désinformation des années 1990
Pourtant, au début des années 1990 en France, l’expertise académique accessible aux médias sur l’histoire de l’Algérie indépendante, même si elle restait trop limitée, ne manquait pas de spécialistes très au fait de la nature de son régime, en particulier du rôle essentiel de la Sécurité militaire[5]. On doit citer notamment Monique Gadant (1931-1995), Gilbert Grandguillaume (né en 1932), Mohammed Harbi (né en 1933), René Gallissot (né en 1934) ou Bruno Étienne (1937-2009), dont les travaux faisaient – et font toujours – référence. Et parmi les plus jeunes à l’époque, figuraient Gilbert Meynier (1942-2017), Omar Carlier (né en 1943), François Burgat (né en 1948), Tassadit Yacine-Titouh (née en 1949), Benjamin Stora (né en 1950), Jean-Pierre Peyroulou (né en 1963) ou Séverine Labat (née en 1966).
Certains de ces universitaires, comme les politologues Bruno Étienne ou François Burgat, ont très tôt alerté dans les médias – arguments solides à l’appui – sur le rôle de la police politique dans la manipulation de la violence islamiste, ce qui leur a alors valu des critiques virulentes. Ils ont pourtant été rejoints par le sociologue Pierre Bourdieu, bon connaisseur de l’Algérie : après un temps d’hésitation en 1993 sur la nature de la politique « éradicatrice » du régime, il l’a très rapidement critiquée ; et en janvier 1998, il dénoncera par exemple avec vigueur le soutien de facto apporté à la junte algérienne dans les colonnes du Monde par Bernard-Henri Lévy, justement qualifié d’« intellectuel négatif » et de « responsable [d’une] opération de basse police symbolique, antithèse absolue de tout ce qui définit l’intellectuel[6] ». Un soutien également démonté par l’historien Pierre Vidal-Naquet, avec lequel j’ai eu alors le privilège de publier sur le sujet[7]. D’autres universitaires et des journalistes avaient tenté d’apporter au grand public un éclairage sur la guerre en cours en Algérie, dans l’ouvrage collectif publié dès juin 1994, Le Drame algérien[8]. Parmi ces journalistes, Catherine Simon au Monde et José Garçon à Libération (et plus tard Jean-Baptiste Rivoire à Canal Plus[9]) ont œuvré durant de longues années pour documenter les réalités de la « sale guerre ».
Et tout particulièrement la manipulation des groupes armés se réclamant de l’islam par le DRS, très tôt identifiée par les spécialistes comme François Burgat, qui expliquait dès février 1995 : « [Les historiens devront] faire l’inventaire d’innombrables provocations policières qui ont systématiquement été inscrites sur l’ardoise islamiste pour tenter de couper [l’islamisme algérien] de sa base électorale. Hocine Aït-Ahmed, le leader du FFS, a dénoncé récemment cette “culture de la manipulation” que le pouvoir militaire, après avoir muselé totalement la presse, a érigée en véritable système de gouvernement. Il faut bien comprendre que c’est moins la violence aveugle contre des innocents que les bulletins de vote qui effraient ce régime-là. Cette violence, non seulement il ne la craint pas, mais il en a en quelque sorte besoin : c’est là que réside aujourd’hui sa seule légitimité. Il faut qu’il puisse brandir ces massacres pour légitimer l’option “éradicatrice” qui seule garantit sa survie. Des doutes réels existent sur l’origine des violences les plus médiatisées attribuées aux islamistes. […] Seuls ceux que je prends le parti d’appeler les “commandos médiatiques” du RCD de Saïd Sadi et du PAGS (ex-communiste), aussi bien implantés dans l’opinion française qu’ils sont marginaux dans le tissu politique algérien, la défendent encore [l’option “éradicatrice”] sur la scène internationale[10]. »
Ces mises en cause légitimes ont été documentées dès la seconde moitié des années 1990 par les enquêtes minutieuses conduites à partir de centaines, puis de milliers, de témoignages de victimes de la répression (dont ceux des familles de « disparus ») par de grandes organisations internationales de défense des droits humains comme Amnesty International et Human Rights Watch, ou par des organisations plus spécialisées comme Algeria-Watch (créée en 1997) ou SOS Disparus (créée en 1998)[11]. L’hypothèse de l’implication directe dans ces crimes des chefs de l’armée et du DRS a alors été confortée par les témoignages de dizaines de policiers et de militaires dissidents, d’abord anonymes, publiés surtout dans la presse britannique[12]. Elle sera confirmée lors des atroces massacres de 1996-1998 dans la Mitidja et à l’Est du pays, revendiqués par les GIA. Car l’origine réelle de ces revendications, comme des précédentes, a été également questionnée preuves à l’appui par les ONG. Au début des années 2000, ces interrogations sont étayées par des témoignages détaillés rendus publics, à visage découvert cette fois, dont ceux de Nesroulah Yous, rescapé du massacre de Bentalha en septembre 1997, de l’ancien sous-lieutenant des forces spéciales Habib Souaïdia ou de l’ex-colonel du DRS Mohammed Samraoui[13].
Et pourtant, rien n’y a fait : ces discours de vérité, loin d’être relayés par les médias français « qui font l’opinion », y ont alors souvent été dénoncés comme des falsifications, « faisant le jeu du terrorisme islamique ». Ce que résumait à sa manière le mouvement Génération Écologie dans son appel à un meeting parisien du 21 janvier 1998, titré « Algérie : le silence tue » : « S’il est vrai que nul n’est parfait, et surtout pas le régime algérien, les assassins, égorgeurs, découpeurs, violeurs, éviscérateurs, sont bien pires. […] La gravité de la situation nous impose désormais de mettre en accusation les assassins avant les autocrates. » Citant ces phrases dans un article publié en novembre 1998 dans le premier numéro de Mouvements, dont le dossier était déjà consacré au thème « Algérie, le défi du dialogue », je commentais : « L’amalgame entre islam, islamisme et terrorisme génocidaire tient lieu d’explication totale. C’est sans doute en France que le caractère d’évidence de cet amalgame est aujourd’hui le plus fortement prégnant dans les grands médias, et il y a à cela des raisons qui mériteraient d’être analysées en détail. Mais il faut en tout cas le dire avec force : cet amalgame ne peut apporter aucune clé d’explication à la tragédie algérienne, car il occulte l’essentiel d’une réalité complexe et ne peut servir qu’à justifier les pires dérapages[14]. »
De fait, les facteurs expliquant la puissance de cet amalgame sont multiples : héritage du racisme colonial ayant prévalu pendant cent trente-deux ans en Algérie, liens étroits tissés depuis l’indépendance entre dirigeants politiques des deux pays, dépendance de l’économie par rapport aux hydrocarbures algériens, importance des circuits de commissions et de rétrocommissions algéro-françaises, chantage au terrorisme exercé par les généraux algériens sur les responsables politiques français, rôle des agents de la SM en France dans les campagnes de désinformation visant intellectuel·les et journalistes[15]…
Cette conjonction de facteurs structurels a alors été aggravée par l’impossibilité absolue de mener des enquêtes indépendantes dans l’Algérie soumise à l’état d’urgence (les correspondant·es étranger·ères ont été invité·es à quitter le pays en 1993). Et par l’impossibilité a fortiori pour les universitaires de conduire des enquêtes de terrain, ce qui a conduit à une déshérence dramatique de la recherche académique sur l’Algérie, pratiquement jusqu’aux années 2010[16]. Du coup, dans les années 1990, les médias (surtout audiovisuels) donnaient principalement la parole aux propagandistes relayant les discours « éradicateurs » du régime ou aux très rares chercheur·ses qui produisaient encore sur la situation algérienne à partir de sources mal maîtrisées. Tandis que les spécialistes de l’Algérie et des réalités de l’islam politique[17] n’étaient pas entendu·es dans les grands médias.
Avec le Hirak, un renouvellement du regard français sur l’Algérie
Vingt-deux ans après la grande campagne de désinformation de 1998[18], force est de reconnaître que ses effets n’ont pas disparu du côté des médias français dominants où, surtout dans les premiers mois du Hirak, les « experts » français et algériens – tous masculins – mobilisés sur nombre de plateaux télévisés étaient souvent ceux qui avaient été les promoteurs de l’injonction « de mettre en accusation les assassins avant les autocrates ». Et cela alors même que cet argument émotionnel, visant à l’époque à écarter toute analyse rationnelle des motivations respectives des assassins (manipulés ou non) et des autocrates arabes confrontés aux mobilisations islamistes, n’a jamais eu la moindre pertinence explicative, a fortiori pour tenter de comprendre les ressorts d’un mouvement populaire où le rôle de l’islam politique est clairement marginal.
Cette propension de certains rédacteurs en chef de la télévision à privilégier la parole de pseudo-experts idéologues est largement le résultat de deux décennies de désintérêt pour l’actualité algérienne (jugée « trop compliquée », comme beaucoup l’ont expliqué en privé, j’en ai été témoin). À partir des années 2000, la plupart des quotidiens et des hebdomadaires qui donnaient le « la » en la matière n’ont pas remplacé leurs journalistes spécialistes du pays, parti·es à la retraite ou évincé·es par les plans sociaux. Même situation dans les chaînes de télévision, souvent promptes en revanche à diffuser des documentaires de journalistes proches du régime algérien et relayant ses « vérités officielles » n’ayant qu’un rapport très lointain avec la réalité, par exemple sur les actions terroristes ayant visé la France : détournement d’un Airbus à Alger en décembre 1994, attentats de Paris en 1995 ou assassinat des moines de Tibhirine en 1996.
Heureusement, l’ampleur inédite et spectaculaire du Hirak a profondément bouleversé cette situation médiatique si longtemps figée. En premier lieu, confrontée à la difficulté persistante d’obtenir des visas pour leurs reporters français, les rédactions de plusieurs quotidiens et hebdomadaires ont intensifié le recours à des journalistes algérien.ne.s, qui ont pu proposer de très nombreux reportages de bonne facture. En deuxième lieu, certaines avancées, certes plus timides, ont été notables dans la presse audiovisuelle ; cela a particulièrement été le cas dans plusieurs chaînes du service public (comme France Culture, RFI, Arte, TV5 Monde ou France 24), qui ont multiplié reportages et plateaux aux approches riches et renouvelées. Et (peut-être ?) surtout, de nouveaux sites d’information en ligne de grande qualité ont puissamment contribué – réseaux sociaux à l’appui – à mieux rendre compte de l’actualité algérienne.
Cette évolution a été favorisée par le renouveau de la recherche universitaire française et franco-algérienne depuis les années 2000, grâce à l’investissement de jeunes chercheuses et chercheurs de grande valeur, dont les travaux restent encore peu connus en dehors des cercles académiques[19]. Comme ces travaux concernent souvent les questions de société au cœur du mouvement populaire, nombre de leurs auteur.e.s ont été invité.e.s à s’exprimer dans la presse écrite comme dans diverses émissions.
Une difficulté persistante des grands médias français reste toutefois l’explicitation du rôle, perçu comme « opaque », des chefs de l’armée et de la police politique toujours au cœur du pouvoir au printemps 2020 malgré les coups de boutoir du Hirak. Illustration de cet état de fait, l’étonnante élection présidentielle du 12 décembre 2019 : élu officiellement avec 58 % des suffrages exprimés et une abstention de 60 % (en réalité de l’ordre de 90 %, selon des journalistes algériens bien informés), Abdelmadjid Tebboune (soixante-quinze ans) n’est en effet qu’un pâle technocrate aux ordres, installé par les « décideurs » militaires pour succéder au « régime Bouteflika ». Bouteflika dont les grands médias avaient jusque-là fait semblant de croire qu’il représentait l’Algérie réelle, alors qu’il ne présidait qu’une façade pseudo-démocratique mise en place en 1999 par ces « décideurs », au terme de leur « guerre contre les civils » des années 1990. Des généraux dont les générations successives ont pu être parfois divisées, mais qui sont restés unis sur l’essentiel : la préservation d’un « système » leur permettant depuis des décennies de détourner à leur profit les milliards de dollars des circuits de corruption liés aux commissions sur le commerce extérieur. Et même si le Hirak a été utilisé en 2019 par l’état-major de l’armée pour éliminer les chefs de la police politique, désormais sous la coupe de l’ANP, le système reste en place au printemps 2020[20]. Ce que les manifestant·es des vendredis ont continué à dénoncer avec constance, notamment en mettant plus souvent en avant, dans certaines villes (comme à l’Est et en Kabylie), la revendication de vérité et justice portée par les familles de disparus lors de la sale guerre des années 1990[21].
C’est pourquoi les médias français, parfois encore pris dans le schéma algérien des années 1990, auraient intérêt à mieux entendre les analyses parfaitement explicites de ces manifestant.e.s, ayant donné pendant plus d’un an toutes les clés pour comprendre la prétendue « opacité » du régime. Et cela même si la crise du Coronavirus a contraint à l’interruption du mouvement. D’autant plus que cette crise est porteuse de terribles menaces pour la société algérienne, en révélant l’aggravation des criantes inégalités économiques (du fait de l’effondrement des prix des hydrocarbures) et sociales (du fait du confinement et des dégâts en termes de santé publique dans un système en déshérence).
* Éditeur et membre de l’association Algeria-Watch, <www.algeria-watch.org>).
[1] Le travail pionnier et rigoureux de Saphia Arezki a posé d’utiles jalons en ce sens : S. Arezki, De l’ALN à l’ANP, la construction de l’armée algérienne, 1954-1991, Barzakh, Alger, 2018.
[2] Sur l’histoire de l’Algérie indépendante et du rôle central joué par la police politique et l’armée, l’ouvrage de référence reste celui de L. Aggoun et J.-B. Rivoire, Françalgérie, crimes et mensonges d’États, La Découverte, Paris, 2004.
[3] Voir dans ce dossier : L. Baamara, « (Dés)engagements militants et pratiques de la contestation (2011-2019) », p. xxx ; ainsi que les analyses pertinentes de H. Rouibah, « Le Hirak : un processus révolutionnaire algérien », RT France, 22 février 2020 ; et aussi : « Redouane Boudjemaa : “C’est le système qui est en crise, pas l’Algérie” », propos recueillis par H. Mechaï, <Ekho.info>, 27 août 2019.
[4] Pour un rappel lucide de cette réalité, voir l’article de S. Djaafer, « 47 vendredis contre des décennies de régression : le Hirak a remis l’Algérie en mouvement », RadioM, 14 janvier 2020, <frama.link/9aNJ268w>.
[5] Voir B. Stora et C. Boyer, Bibliographie de l’Algérie indépendante, CNRS Éditions, Paris, 2011.
[6] P. Bourdieu, « L’intellectuel négatif », in Contre-Feux, Liber-Raisons d’Agir, Paris, 1998, <frama.link/-j0AkypW>.
[7] Voir notamment F. Gèze et P. Vidal-Naquet, « L’Algérie et les intellectuels français », Le Monde, 4 février 1998.
[8] Reporters sans frontières, Le Drame algérien. Un peuple en otage, La Découverte, Paris, 1994 ; avec notamment des contributions des universitaires Monique Gadant, Mohammed Harbi, Séverine Labat (laquelle se ralliera plus tard aux thèses du régime), Ahmed Rouadjia, Benjamin Stora et Tassadit Yacine ; ainsi que des journalistes Hamid Barrada, Akram Belkaïd, José Garçon, Salima Ghezali, Catherine Jentile et Ghania Mouffok.
[9] Voir notamment ses documentaires Bentalha, autopsie d’un massacre (« Envoyé spécial », septembre 1999) et Algérie, la grande manip. Enquête sur l’assassinat de Lounès Matoub (Canal Plus, 2000).
[10] F. Burgat, « Méfions-nous de tout manichéisme », interview au mensuel Croissance, février 1995.
[11] Voir notamment cette recension de ressources documentaires : Algeria-Watch et S.-E. Sidhoum, « Les disparitions forcées en Algérie : un crime qui perdure », janvier 2002/2014, <frama.link/QmUp8-XC> ; ainsi que : Algeria-Watch et S.-E. Sidhoum, « Algérie : la machine de mort », octobre 2003 (première analyse détaillée du dispositif répressif clandestin mis en place par les généraux algériens) ; ou les dossiers présentés lors de la 32e session du Tribunal permanent des peuples sur « Les violations des droits de l’homme en Algérie (1992-2004) », novembre 2004, <frama.link/YgC9LU9g>. Voir aussi les rapports recensés depuis le début des années 2000 par SOS Disparus et le Collectif des familles de disparus en Algérie, <frama.link/zZHmSmCb>.
[12] Voir par exemple : R. Fisk, « Massacres in Algeria : strong evidence for military security responsability », The Independent, 30 octobre 1997 ; et J. Sweeney, « Atrocities in Algeria : we were the murderers who killed for the State », The Observer, 11 janvier 1998.
[13] N. Yous, avec la collaboration de S. Mellah, Qui a tué à Bentalha ?, La Découverte, Paris, 2000 ; H. Souaïdia. La Sale Guerre. Le témoignage d’un ancien officier des forces spéciales de l’armée algérienne, La Découverte, Paris, 2001 ; M. Samraoui, Chronique des années de sang. Algérie : comment les services secrets ont manipulé les groupes islamistes, Denoël, Paris, 2003 (<algeria-watch.org/?p=22567>).
[14] F. Gèze, « Aux origines de la violence », Mouvements, n° 1, novembre 1998, <algeria-watch.org/?p=60915>. Le sommaire du dossier est accessible à l’adresse <frama.link/7yqF_UrN>.
[15] Voir F. Gèze, « Françalgérie : sang, intox et corruption », Mouvements, no 21-22, 2002, p. 63-73, <frama.link/PFm8Lg5V>.
[16] Voir K. Dirèche, « Écrire sur l’Algérie. Les SHS à l’épreuve de la mobilisation citoyenne du 22 février 2019 », L’Année du Maghreb, n° 21, 2019.
[17] Voir par exemple F. Burgat, L’Islamisme en face, La Découverte, Paris, 1995.
[18] Pour les détails circonstanciés et documentés de cette campagne sans précédent, voir L. Aggoun et J.-B. Rivoire, Françalgérie, crimes et mensonges d’États, op. cit., chapitre 28, « La campagne de neutralisation d’une enquête internationale », p. 535-554.
[19] De ce dynamisme scientifique nouveau, témoignent notamment les soixante-quatre chercheuses et chercheurs réunis in K. Dirèche (dir.), L’Algérie au présent. Entre résistances et changements, Karthala, Paris, 2019.
[20] Sur ces points et d’autres relatifs au Hirak, voir O. Benderra, F. Gèze, R. Lebdjaoui et S. Mellah (dir.), Hirak en Algérie. L’invention d’un soulèvement, La Fabrique, Paris, 2020 (présentation et sommaire : <algeria-watch.org/?p=73058>).
[21] Voir dans ce dossier l’entretien avec Habiba Djahnine.




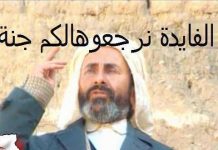










s’accord les médias Francais!!! et les médias algériens vous les aviez oubliés? le fameux el Watan titre ce Matin : Alerte Générale concernant le COVID19???! tous des menteurs! ils mettent la pression sur le gouvernement pour qu’il prononce le confinement?? non seulement le bilan du COVID19 EN Algérie et maigre presque inexistant avec ces 800 morts dont les 98% sont morts d’une autre maladie ou atteint une mort ordinaire l’age etc.. » svp arrêter de mentir! parfois on se demande si ce journal avec d’autre ne collaborent pas avec le pouvoir actuel?? toujours le m^me objectif tuer les algériens les affamés les privés de leurs libertés… on revient aux médias Francais : c’est la m^me analyse que je fais : ce Macron qui aide Haftar en libye il aide donc un dictateur, on les connait les francais sont toujours avec les plus fort…